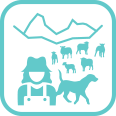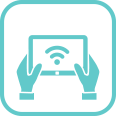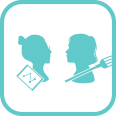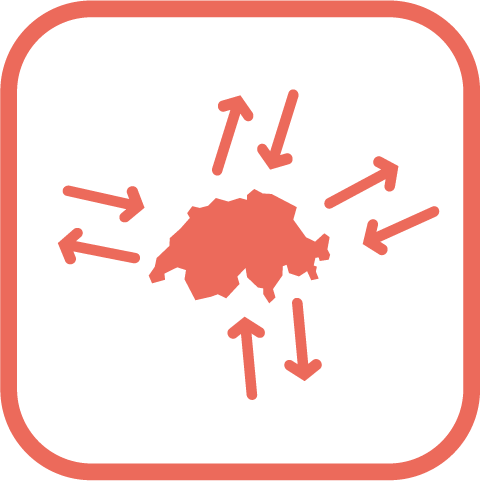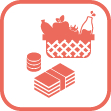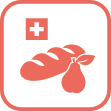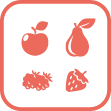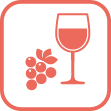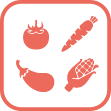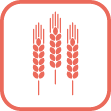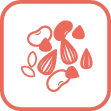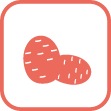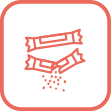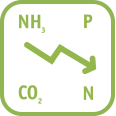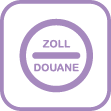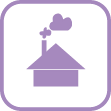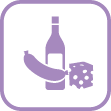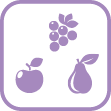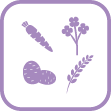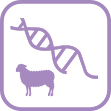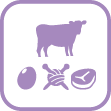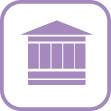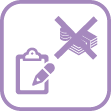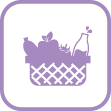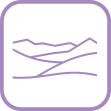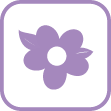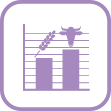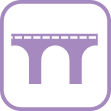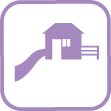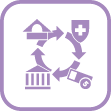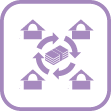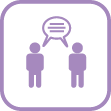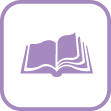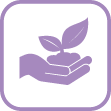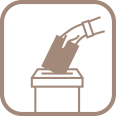Cultures spéciales fruitières, viticoles et maraîchères
L’année 2024 a été marquée d’un côté par un léger recul des surfaces arboricoles et viticoles. De l’autre côté, les variétés robustes de pommes et les cépages résistants aux maladies fongiques ont progressé. Dans la culture des petits fruits, les espèces arbustives ont continué d’avancer. Quant aux légumes frais, ils ont atteint un record de surface cultivée (14 300 hectares).

Fruits
Inclusion de nouvelles cultures dans la statistique
La surface totale des cultures fruitières, dont la définition est donnée à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm), est recensée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) selon l’Enquête sur les cultures fruitières de la Suisse visée à l’annexe 1. ch. 09.43, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale. Depuis le 1er janvier 2023, les cultures de châtaigniers, de figuiers, de noisetiers, de plaqueminiers du Japon (kaki), d’amandiers et d’oliviers sont également considérées comme des cultures fruitières, pour autant que leur surface franchisse le seuil de densité d’arbres fixé à l’art. 22, al. 2, OTerm.
En 2024, l’agriculture suisse a exploité 6110 hectares de cultures fruitières, soit 24 hectares de plus que l’année précédente (+0,4 %). L’augmentation est due au fait que dorénavant, la statistique tient compte des espèces énumérées ci-dessus. Les cultures recensées l’année précédente s’étendaient sur 6062 hectares et comprenaient les arbres suivants : le pommier, le poirier, le cognassier, l’abricotier, le cerisier, le pêcher (pêche et nectarine), le prunier (prune et pruneau), le sureau, l’arbre à kiwi et le noyer. Si l’on tient compte seulement des espèces relevées statistiquement jusqu’à l’année précédente (6086 ha), les surfaces cultivées marquent un recul de 24 hectares (–0,4 %). Mais l’inclusion du seul noisetier (43,3 ha) dans la statistique compense largement la diminution observée dans les fruits à pépins et les fruits à noyau.
Les 6110 hectares de cultures fruitières se décomposent ainsi : 71,5 % de fruits à pépins (4369,3 ha), 25,5 % de fruits à noyau (1557,2 ha), et 2,1 % de fruits à coque (130,4 ha), y compris les châtaignes. Le sureau (25,7 ha) et le kiwi (24,4 ha) occupaient chacun environ 0,4 % de la surface. La surface restante a servi à cultiver des figuiers, des oliviers et des arbres à kaki.
Le lecteur trouvera des données complètes sur les cultures fruitières en Suisse dans la statistique des cultures fruitières 2024, par cultures et par variétés, ainsi qu’une comparaison avec les années précédentes.
Augmentation des surfaces de variétés robustes de pommes
Depuis le 1er janvier 2023, la Confédération alloue des aides à la plantation de variétés robustes de fruits à pépins, comme le prévoit l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). Il s’agit de cultiver des variétés de pommes exigeant moins de traitements aux produits phytosanitaires. L’OFAG détermine les variétés donnant droit à ces aides financières, conformément à l’annexe 6, ch. 3.2.2, let. f, de l’OAS. La liste des variétés robustes de pommes a été dressée conjointement par l’OFAG, le monde de la recherche, les cantons et les représentants de la branche. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des surfaces réservées à ces variétés (selon liste des variétés au 1er novembre 2023).
Nouvelle progression des espèces arbustives de petits fruits
Les statistiques de l’interprofession Fruit-Union Suisse (FUS) indiquent que les cultures de petits fruits s’étendaient en 2024 sur 915 hectares, une surface très proche de celle de 2023 (917 ha). Tandis que les cultures d’espèces arbustives ont pris de l’ampleur comme l’année précédente, les cultures de fraises ont de nouveau perdu presque 20 hectares. Précisons que le sureau n’est pas compris dans les petits fruits, puisqu’il est porté au compte des culture fruitières. De même, la présente statistique ne tient pas compte des petits fruits qui ne figurent pas séparément dans le rapport annuel de la FUS.
Vignes
Petite diminution de la surface viticole
Le vignoble suisse s’étendait en 2024 sur 14 484 hectares, soit 85 hectares de moins qu’en 2023 (–0,6 %). Les cépages blancs occupaient 6469 hectares (–14 ha ou –0,2 %) et les rouges 8015 hectares (–71 ha ou –0,9 %). Comme en 2023 ou presque, les cépages blancs représentaient 45 % du vignoble et les rouges 55 %.
Nouvelle progression des variétés résistantes aux maladies fongiques
Entre 2019 et 2024, la surface viticole en Suisse a diminué de 220 hectares, ce qui correspond à une baisse de 1,5 %. Alors que la surface totale a diminué, la surface des cépages résistants aux champignons a augmenté. Ces cépages se caractérisent par une résistance élevée aux principales maladies cryptogamiques et requièrent nettement moins de pesticides, ce qui les rend particulièrement intéressants du point de vue écologique. Depuis le 1er janvier 2023, l’OFAG accorde des aides financières à la plantation de cépages robustes (OAS, RS 913.1).
De 2019 à 2024, la surface totale dévolue aux cépages résistants aux champignons a augmenté de 254 hectares, soit une hausse de 80,5 %. En 2024, elle s’élevait à 570 hectares et représentait 3,9 % de la surface viticole totale. Les cinq cépages blancs résistants aux maladies fongiques les plus plantés en Suisse en 2024 étaient le Souvignier Gris, le Johanniter, le Solaris, le Sauvignac et le Muscaris. Comme l’année précédente, les cinq cépages rouges résistants aux maladies fongiques les plus plantés étaient le Divico, le Cabernet Jura, le Regent, le Maréchal Foch et le VB cal 1–28, succédant au Léon Millot à la cinquième place. Il s’avère que les anciens cépages établis (p. ex. le Léon Millot) disparaissent lentement et sont remplacés par des cépages plus récents, plus intéressants pour la vinification et la commercialisation.
Le lecteur trouvera de plus amples informations dans la publication « L’année viticole ».
Légumes
Selon les relevés de la Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales, la culture effective de légumes frais (légumes de garde inclus) s’élevait en 2024 à 14 522 hectares, soit 254 hectares de plus qu’en 2023. Cette surface se composait de la culture effective (y compris les cultures successives sur une même surface) de 13 627 hectares de légumes de plein champ (sans les légumes ordinairement destinés à la transformation) et de 895 hectares de légumes sous serre. La surface de culture des légumes de plein champ a augmenté de 2 % au cours de l’année sous revue par rapport à 2023, celle des légumes sous serre ayant reculé de près de 3 %.
Depuis plusieurs années, les cinq premières places dans la culture des légumes de plein champ sont occupées par la carotte, l’oignon jaune, le brocoli, la laitue iceberg et le chou-fleur. La carotte et la laitue iceberg sont restées plus ou moins au niveau de l’année précédente, tandis que l’oignon jaune et le brocoli ont progressé l’un et l’autre de plus de 3 %, le chou-fleur accusant une diminution de quelque 2 %. En 2024, les cinq principales cultures sous serre en termes de surface étaient de nouveau la doucette, suivie des radis, des concombres à salade, de la laitue pommée verte et de la tomate en grappes. Par rapport à 2023, les variations sont les suivantes : doucette : –5 % ; radis : –8 % ; tomate en grappes : –17 % ; laitue pommée verte : –1 %. Seule la culture de concombres à salade a légèrement augmenté, de 1 %.
Liens vers le site Internet de l’OFAG :
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».